
| peintres-officiels-de-la-marine.com | e-mail: librairie.maritime@gmail.com |
| galerie-POM à Brest. |
 |
| " L'art nous apporte l'assurance que tout ne meurt pas". charles Lapicque. |
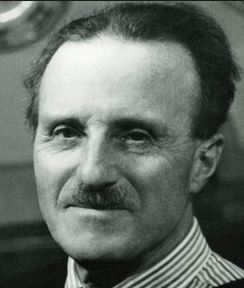
LAPICQUE Charles .
Né en 1898 à
Theizé.
Décédé en 1988. (90 ans)
nommé peintre
officiel de la marine de 1948 à 1966.peintre au département de
la marine pendant 17 ans
il a embarqué sur des
avisos
Son
oeuvre est tres colorée,et souvent formée d'arabesques
,le réel est souvent complété par l'imaginaire.
Charles LAPICQUE
est élevé par ses grands parents , sortie de l'école centrale
(1921),il devient ingénieur dans la
distribution électrique!
il affectionne la mer, les
bateaux, et passe ses vacances en
bretagne. Il commence la peinture en 1920 Au début Lapique ingénieur est un artiste amateur ,et
il conduit des recherches sur la perception des couleurs,
Au début Lapique ingénieur est un artiste amateur ,et
il conduit des recherches sur la perception des couleurs,
sportif,musicien il est doué,
sa palette represente de tres nombreux sujets,c'est en
1900 à deux ans que les parents de Lapique lui
montrent le bord de mer,et une grande partie de sa vie il
observe la mer à Ploubazlanec,chaque été ,la cote est
représentée de façon abstraite ,la Bretagne sera pour lui une
source d'inspiration majeure.
Sa femme l'incite a se lancer dans la peinture il quitte son
métier.(1939) commence avec une peinture
complètement abstraite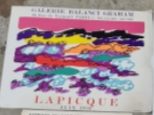 Ensuite il
évolura vers du "figuratif gestuel, figuration allusive!
" (années 1950),
Ensuite il
évolura vers du "figuratif gestuel, figuration allusive!
" (années 1950),
L'élaboration de la couleur dirige son oeuvre, la
couleur est appliquée en nappes ou rubans,des boucles des
serpentins,des tortillons,des entrelacs,
Intégration du mouvement dans l'image
,voir sa grande série sur les régates,(il possédait un
voilier)
'inspiration,en
Grèce il
représente aussi des animaux( fauves) souvents ses personnages
et objets sont cernés de blanc ou noir pour faire ressortir la
couleur.
il
représente aussi des animaux( fauves) souvents ses personnages
et objets sont cernés de blanc ou noir pour faire ressortir la
couleur.
Homme de vaste culture, passionné de
musique il est nommé peintre officiel de marine en
1948.,il effraie les officiers
avec ses peintures,aussi en 1967
il quitte la marine nationale pour revenir "au cotier" .
harles Lapicque est un artiste
peintre français de la nouvelle école de
Paris , né à Theizé en 1898 mort à
Orsay en 1988.
Ses œuvres furent jugées importantes, entre 1939 et 1943, pour
le développement de la peinture non figurative et
dans les années 1950 pour les courants Pop artfiguration naive.
Charles Lapicque naît le 6 octobre 1898 à Theizé, dans le
Rhone, d'une famille originaire des Vosges. Il est le fils
adoptif de louis Lapicque professeur de
physiologie général à la Faculté des sciences de Paris.
Il passe sa petite enfance à Epinal et fait en
1900 son premier séjour en bretagne près de
Paimpol , où il retourne longtemps chaque été
. Il commence en 1903 l'étude du piano.
À partir de 1909 il habite Paris où il suit ses études
secondaires, pratique le dessin au lycée puis dans les académies
libres, aborde la pratique du violon
. Mobilisé de 1917 à 1919 dans l'artillerie de campagne, il y
acquiert une connaissance des chevaux qui se retrouvera plus
tard dans ses peintures, participe aux combats de 1918 et
recevra la Croix de Guerre
.En 1919 Charles Lapicque entre à école des arts et manufactures
à Paris, s'intéressant particulièrement aux projections et
perspectives utilisées dans le dessin industriel.
Il peint en 1920 ses premiers paysages près de Caen.
Ingénieur dans la distribution d'énergie électrique,
il dirige en 1921 un secteur près de Lisieux où il assure la
construction et l'exploitation de lignes à haute tension.
Appelé au Bureau d'études techniques il s'installe à Paris
en 1924, peignant le dimanche paysages et marines. Ses
recherches plastiques, dans le climat du cubisme, développent
les études qu'il a poursuivies sur les modes de projection dans
l'espace
. En 1925 son Hommage à Palistrina se
dégage de toute visée figurative et suscite les encouragements
de Jeanne Bucher qui lui propose de devenir « peintre de la
galerie ».
Il abandonne en 1928 sa carrière d'ingénieur pour se
consacrer à la peinture
, réalisant en 1929 sa première exposition personnelle à la
Galerie jeanne Bucher Charles Lapicque reprend ses
études à la Faculté des sciences de Paris, obtient la licence ès
sciences physique et commence une thèse pour le doctorat ès
sciences physiques sous la direction de charles Fabry Sur
recommandation d'André Denieme il occupe de 1931 à 1943 un
poste d'assistant préparateur auprès de maurice
Curie professeur de physique du certificat P.C.B. Il
fréquente alors les physicien alber arluf et rené Lucas
À la faculté il entreprend des recherches sur la
perception des couleurs qui le conduisent à renverser la loi
classique de leur échelonnement dans l'espace, Lapicque
observant que le bleu constitue en fait la couleur du plus
proche, le rouge du plus lointain.
Afin de perfectionner ses connaissances il entre à l
'école supérieure d'optique dont il sort ingénieur-opticien
diplômé en 1934.
Il s'intéresse parallèlement, dans les musées et chez les
antiquaires, aux œuvres artisanales anciennes, enluminures,
tapisseries médiévales, émaux poitevins, faïences, dans
lesquelles il trouve des confirmations de ses théories et fait
plusieurs communications aux réunions de l institut
optique , notamment, en 1935, sur « le rouge et le bleu
dans les Arts ».
Charles Lapicque rencontre en 1936 le philosophe gabriel Marcel
qui l'invite à des séances de discussion et lui fait connaître
jean Whal c'est le point de départ de sa réflexion philosophique
et esthétique. Il reçoit en 1937 la commande de cinq grandes
décorations murales pour le Palais de la Découverte à Paris,
l'une d'elle, La synthèse organique (10 x 10 m), lui valant une médaille
d'honneur à l'Exposition Universelle de 1937.
Après avoir été nommé boursier de recherches de la caisse
nationale recherche scientifique Lapicque soutient sa
thèse de doctorat ès sciences physiques en 1938 sur
« l'optique de l'œil et la vision des contours »,
devant un jury présidé par charles fabry et comprenant
comme examinateurs henri chretien
et henri Laugier tandis qu'il réalise plusieurs
sculptures (granit). S'intéressant aux arts africains et
précolombiens, il aborde parallèlement la clarinette, le basson,
le trombone et pratique durant dix ans le cor dans des ensembles
amateurs.
Mobilisé au centre national de la recherche
scientifique Lapicque est en 1939 chargé d'études sur la
vision nocturne et le camouflage, travaillant avec Saint
Ex.
Démobilisé, il commence d'appliquer ses théories dans une série
de Figures armées qui posent les basses d'une peinture
nouvelle et participe en 1941 à l'exposition des vingt
jeunes peintres de tradition française organisée par
jean Bazaine première manifestation de la peinture
d'avant-garde sous l'Occupation, alors que le nazisme multiplie
les condamnations de « l'art dégénéré ».
Il fait à nouveau en 1943 un bref séjour en Bretagne.
Un contrat avec la Galerie Louis Carré lui permet d'abandonner
son poste de préparateur à la Faculté des Sciences.
Il peint en 1944 plusieurs toiles autour de la liberation
de Paris et retrouve durant l'été 1945 le chemin de la Bretagne.
La Galerie Carré présente en 1946 une exposition
« Bazaine Esteve , Lapicque »
Charles Lapicque fait en 1948 une première conférence au
collège de philosophie
Il est nommé peintre du
Département de la Marine et participe à de nombreuses
manœuvres au large de Brest (1948), de Toulon (1949), en
Afrique du Nord (1951).
À l’automne 1958, Charles
Lapicque embarque sur un aviso de la Marine nationale pour
suivre les grandes manœuvres navales qui vont se dérouler dans
la rade de Brest. Pendant plusieurs jours, le peintre ne
cessera de dessiner tout ce qu’il voit ; des croquis à
partir desquels, de retour à l’atelier, il élabore une
nouvelle série picturale qui l’occupera une bonne partie de 1959, délaissant celle
qu’il consacrait jusque-là à l’histoire…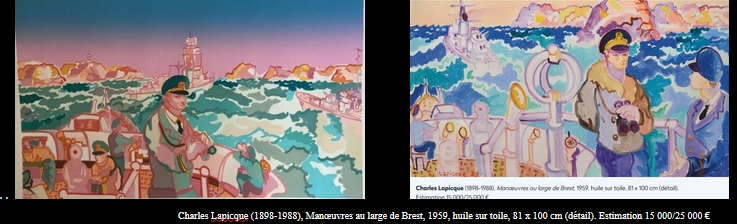
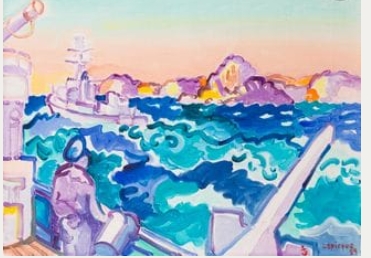

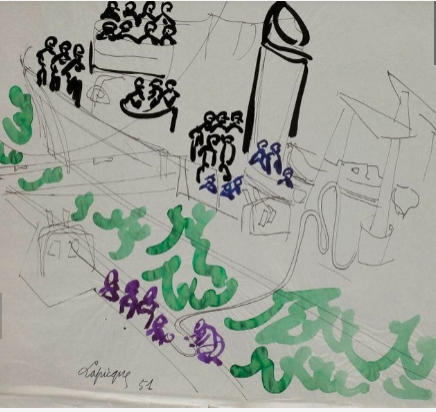 
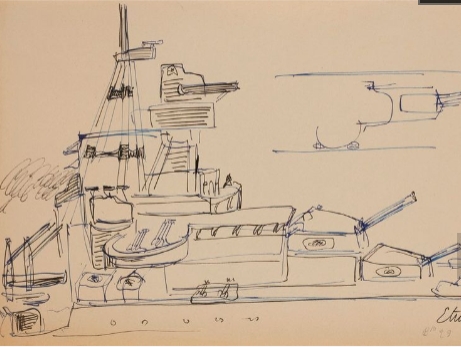

|
||
 aquarelle encadrée "bord de mer." aquarelle encadrée "bord de mer."
|
la signature du peintre est rarement suivie de l'ancre de marine uniquement ses oeuvres marine nationale comme"manoeuvre de nuit sur le Pimodan" ou "destroyers en manoeuvre" etc... |
|
| . estampes | de Lapique. | |
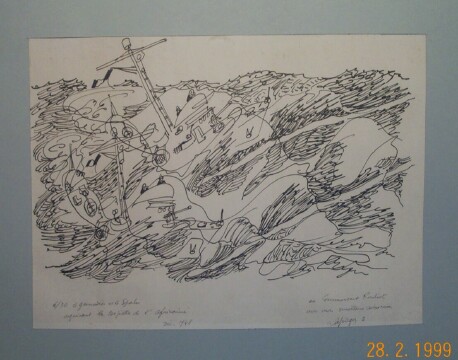 On remarque surtout le
mouvement On remarque surtout le
mouvement |
Le
GRENADIER et le SPAHI esquivant les torpilles de l'AFRICAINE. Décembre
1948.lithographie en vente : 152 euros |
|
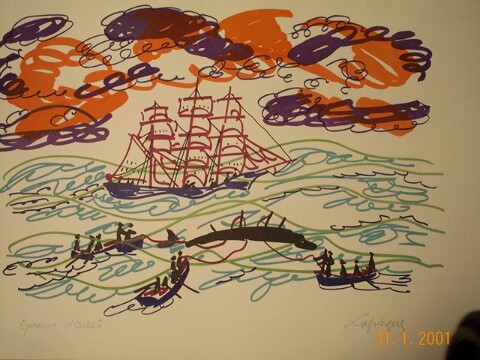 |
La chasse à la baleine
1969. Lithographie en couleur
|
|
 |
Le Retour de péche.
1969. Lithographie en couleur sur pierre |
|
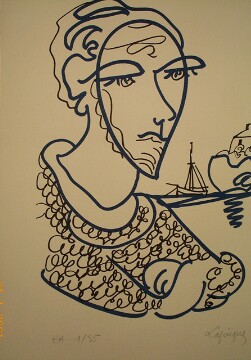 il a réalisé une série de portraits il a réalisé une série de portraits |
Mon frére Yves 1960 Le marin . Lithographie en deux couleurs hauteur 54 Larg 38cm prix 144 euros |
|
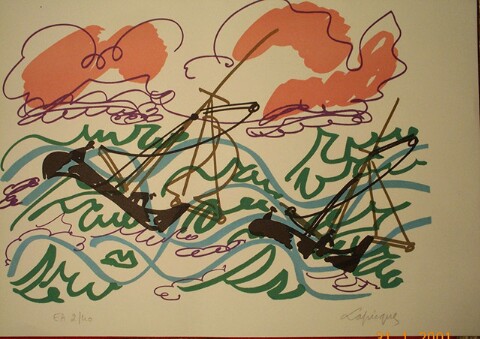 |
Gros temps. . 1969 Lithographie en couleur sur numéro 406 du catalogue.
|
|
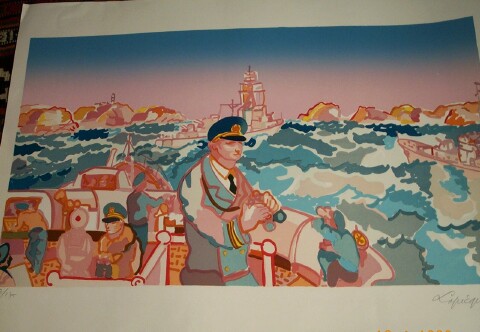 |
prix 304 euros. | |
| Bibliographie. |
 Lapique-
Estampes par Mr Balanci et Me
Blache Lapique-
Estampes par Mr Balanci et Me
Blache Catalogue de toutes les estampes de Lapique.. |
| Lapique,l'art et le Monde de madame Georget. |
| aussi nous
devons vous préciser La cote du peintre.
Quand on pense, marché de l'art, on doit penser, ventes publiques,en effet maintenant le marché est beaucoup plus "global" il ne s'arréte pas à une galerie ,ou un artiste qui fixe unilatéralement le prix de ses oeuvres,on peut dire qu'il y a une irrésistible ascension des maisons de ventes aux enchères, au détriment des marchands traditionnels. La diffusion d'un grand nombre de catalogues,( par internet et les autres supports.) indique au public les vrais prix du marché. Il est évident que le prix de vente publique,en libre concurrence refléte l' offre et la demande. De plus on sait que souvent le marché des salles de ventes est un lieu ou s'approvisionnent les marchands,donc un particulier a l'impression d' acheter à des prix de marchands. Au siécle dernier nous avions "les Salons et les Académies"qui définisaient les normes de l'art.Ces normes étaient balayées réguliérement par les artistes d'avant-garde et les marchands,éclaireurs de l'esthétique,de nos jour tout cela a éclaté,rien n'est aussi rigide |
||||||||||||
novembre 2020 vente Ader 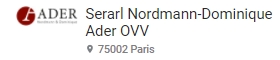 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2019
vente de 135 lithographies de Lapicque
charles 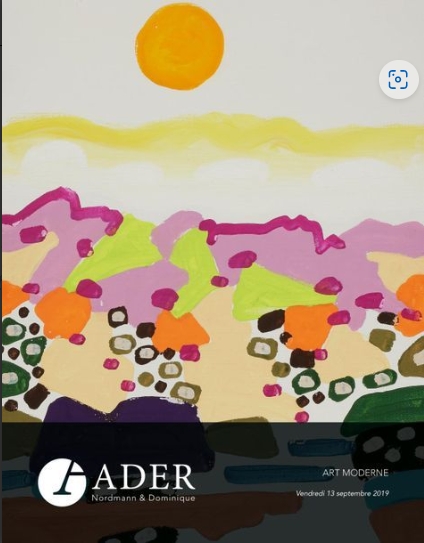
 
|
||||||||||||
Février 2013.
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Quelques prix en 2005.
|
||||||||||||
| Une huile sur toile" La petite
péche " signée et datée 73x92cm est estimée
300 000 fr.! |
||||||||||||
Provenant de la
collection de madame Elmina Auger.Le vendredi 14 juin
2002 à b14h30Drouot maitre Laurin:Guilloux/Buffetaud
commissaires priseurs.
"Yatching à basse mer "encre sur papier45x55 13300 francs "la bouée à virer" huile sur toile 139x89cm 560.000 francs! "destroyers en manoeuvre"encre de couleurs sur papier .17.500 francs. "le canot à voile" gouache,encre et pastel 32x49cm: 21.000 francs. "bouée à virer" gouache et pastel sur papier 31x49cm /12.600 francs. "l'embarquement pour Cythère" acrylique sur toile 60x73cm/ 56.000 francs. "ferme sur le rivage" acrylique sur toile 54x73cm 63.000 francs. " force huit" acrylique sur toile 60x81cm 122.000 francs."le phare des Héaux" huile sur papier 31x39cm 80.000 francs |
||||||||||||
| le 16 décembre 2015 |
.Commentaires de nos
lecteurs sur cette page "Lapicque".et vu sur
internet.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 vente d'estampes de Lapicque-charles.
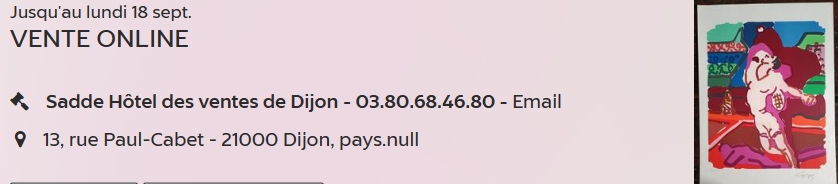 prix de 100 à 180 euros.
prix de 100 à 180 euros.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 novembre
2022 monsieur
vente de nombreuses
lithographies de Charles Lapicque étude de
RENNES ENCHERES
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
octobre 2022. vente oeuvre
Lapicque.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
le 3 juin 2022. vente Oeuvre
Lapicque.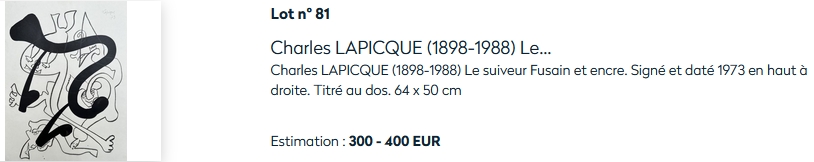
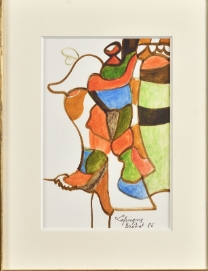
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| le 23 avril 2022. vente de deux oeuvres de Lapicque. 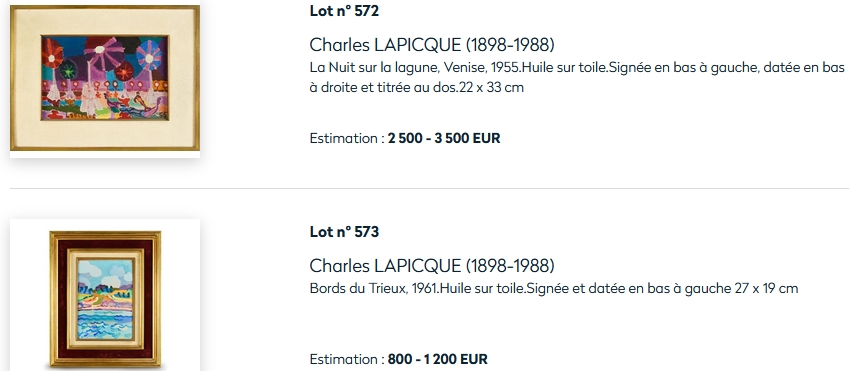 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| le 15 novembre 2021 . 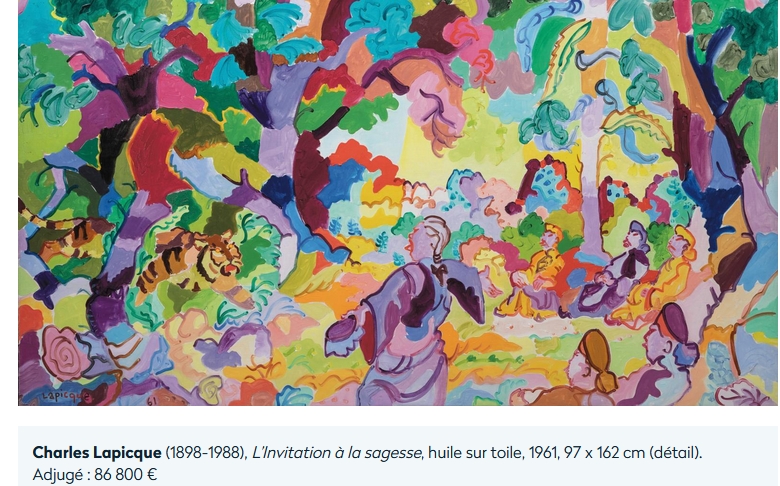 vendue 86.800
euros.
en matière de coloris, Charles
Lapicque remportait la première place, à travers
58 toiles provenant de la collection Alain et
Violette Merle (petite-fille du peintre), qui
totalisaient 880 000 € Ressortait de ce panorama de
l’œuvre de l’artiste, car adjugée 86 800 €, L’Invitation
à la sagesse de 1961 (97 x 162 cm), une
grande composition avec tigre et assemblée de sages. À
80 600 €, c’était San
Zaccaria, brossé après un voyage à Venise, qui
trouvait aussi amateur, alors qu’un Paysage
de l’Atlas saharien de 1951 (96 x 130 cm) partait
à 53 320 €. vendue 86.800
euros.
en matière de coloris, Charles
Lapicque remportait la première place, à travers
58 toiles provenant de la collection Alain et
Violette Merle (petite-fille du peintre), qui
totalisaient 880 000 € Ressortait de ce panorama de
l’œuvre de l’artiste, car adjugée 86 800 €, L’Invitation
à la sagesse de 1961 (97 x 162 cm), une
grande composition avec tigre et assemblée de sages. À
80 600 €, c’était San
Zaccaria, brossé après un voyage à Venise, qui
trouvait aussi amateur, alors qu’un Paysage
de l’Atlas saharien de 1951 (96 x 130 cm) partait
à 53 320 €. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| le 2 novembre 2021. Vente d'oeuvres de Charles Lapicque. 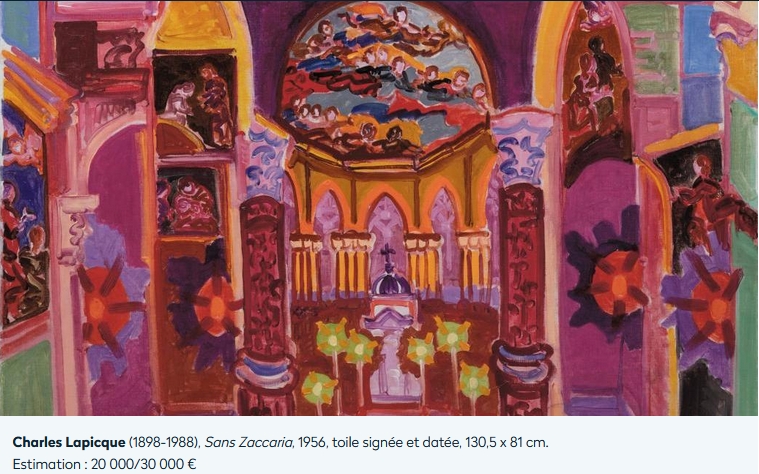 Charles Lapicque,
avec une soixantaine d’œuvres provenant notamment de
la collection Alain et Violette Merle, cette dernière
étant la petite-fille du peintre. Ces tableaux offrent
un beau panorama sur la carrière d’un artiste
inclassable, qui s’inspira autant du cubisme que des
vitraux médiévaux. Il se déploiera de la toile datant
de 1938, Le 11 Novembre, où la couleur se
fait déjà puissante (10 000/15 000 €), jusqu’à Force
huit de
1971 (à envisager à 15 000/20 000 €), en passant par
les Manœuvres de nuit, toile de 1958.
Celle-ci évoque sa nomination de peintre de la Marine,
en 1949, et ses voyages, notamment à Brest en 1958 à
bord de l’aviso Pimodan, et est estimée
30 000/40 000 €. Charles Lapicque,
avec une soixantaine d’œuvres provenant notamment de
la collection Alain et Violette Merle, cette dernière
étant la petite-fille du peintre. Ces tableaux offrent
un beau panorama sur la carrière d’un artiste
inclassable, qui s’inspira autant du cubisme que des
vitraux médiévaux. Il se déploiera de la toile datant
de 1938, Le 11 Novembre, où la couleur se
fait déjà puissante (10 000/15 000 €), jusqu’à Force
huit de
1971 (à envisager à 15 000/20 000 €), en passant par
les Manœuvres de nuit, toile de 1958.
Celle-ci évoque sa nomination de peintre de la Marine,
en 1949, et ses voyages, notamment à Brest en 1958 à
bord de l’aviso Pimodan, et est estimée
30 000/40 000 €.des précisions ? prix dimensions etc ....cliquez sur l'image .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
le 17
septembre 2009 cette estampe épreuve d'artiste représente
"un croiseur en mer"
vendue 150 euros
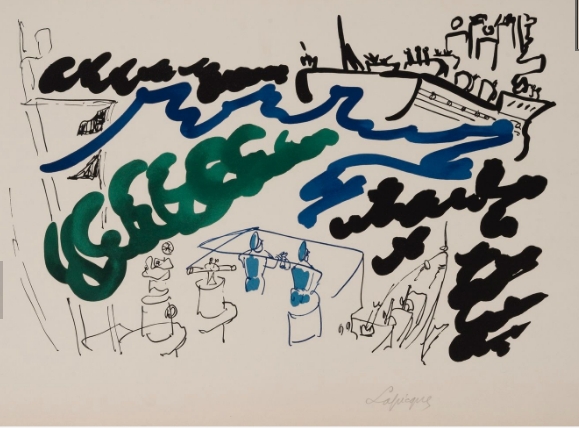 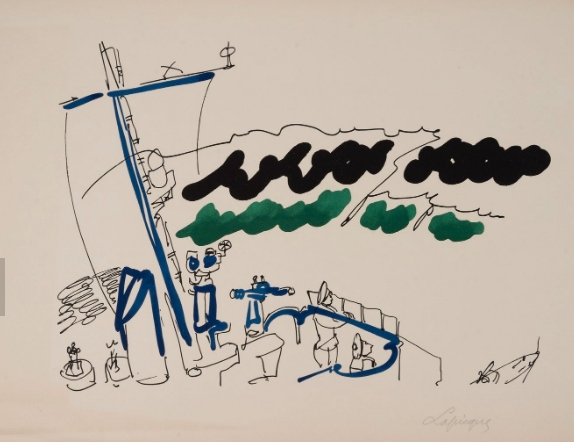 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
le 5 octobre
2008. Monsieur veuillez trouver cette estampe
maritime de Lapicque que j'ai vu en vente. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
le 1 septembre
2009. Monsieur allez voir l'exposition Charles Lapicque au
musée de la poste c'est les derniers jours
cordialement http://www.laposte.fr/groupe_poste_page_accueil_groupe_actualites_38charles_lapicque_une_retrospective-_2175.html http://www.laposte.fr/groupe_poste_page_accueil_groupe_actualites_38charles_lapicque_une_retrospective-_2175.html
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le 14 avril
2008. monsieur Je viens de voir dans le
metro parisien une affiche sur le 119ém salon des
indépendants avec un hommage à Charles
Lapicque. Du 11 au 16 avril
2008.
bien cordialement.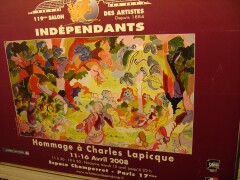 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
le 07 février
2008. monsieur aujourd'hui j'ai vu cette
estampe à vendre en voici une photographie pour agrémenter
le site cordialement |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
le 22 novembre
2007.monsieur vu à la vente cette encre de
chine"bord de mer"
sur papier signée de 45x56cm estimée 3.000 euros
cordialement.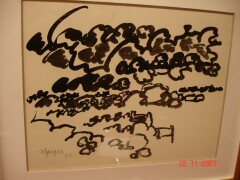 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE 24 DECEMBRE 2004. Monsieur, Je suis vendeur d'une très belle litho de CH. Lapicque. Format 62 x 82 portant le numéro 72/175. Elle représente un petit port entouré d'une luxuriance d'arbres. Pouvez-vous faire quelque chose pour moi.Par avance merci drasseled@wanadoo.fr |
| Liens internet.en rapport avec l la présente page n'hésitez pas à nous | indiquer des liens qui peuvent compléter le contenu.. | Bon surf... | ..cliquez sur
l'image...dimensions étude prix |
|||||
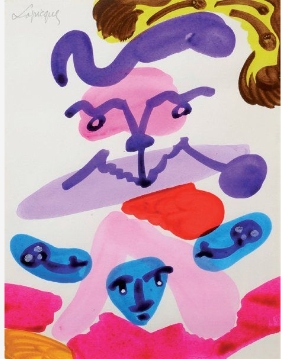 |
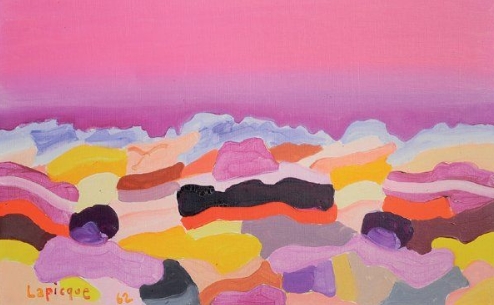 |
.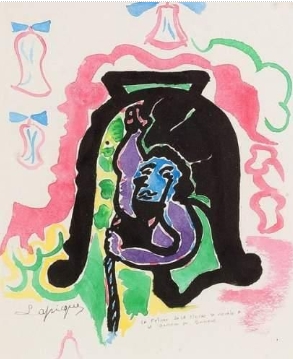 . .
|

|
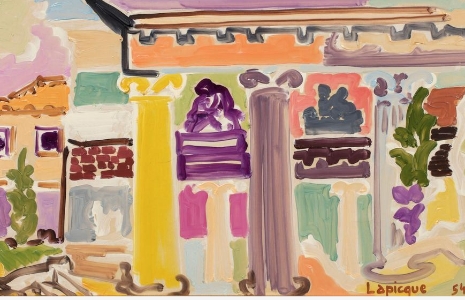 |
||||
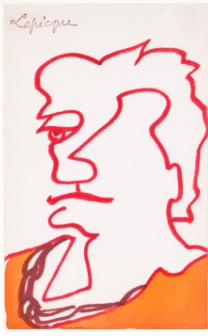 |
https://beaux-arts.dijon.fr/sites/default/files/Collections/XX/pdf/lapicque.pdf |
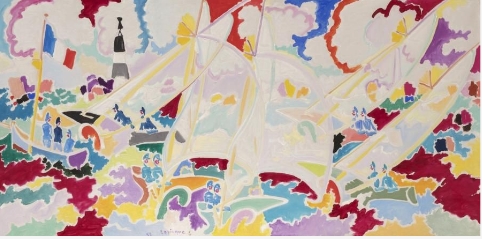 le canot but. |
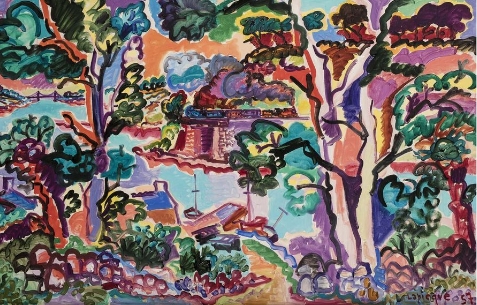 |
|||||
|
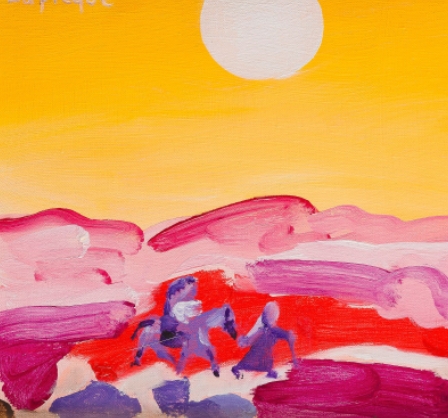 |
 |
 |
|||||
 |

|
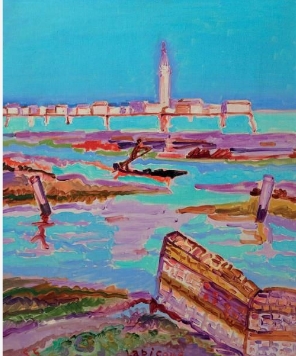 |
 |
 |
||||
 |
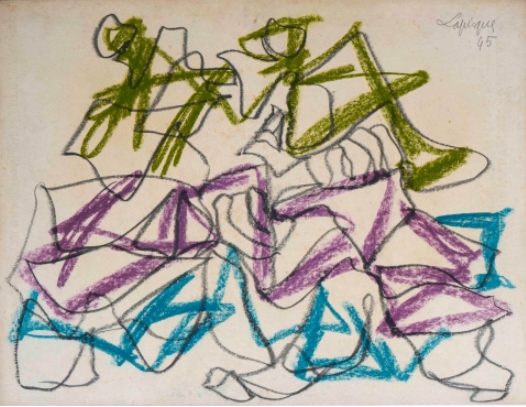 |
 |
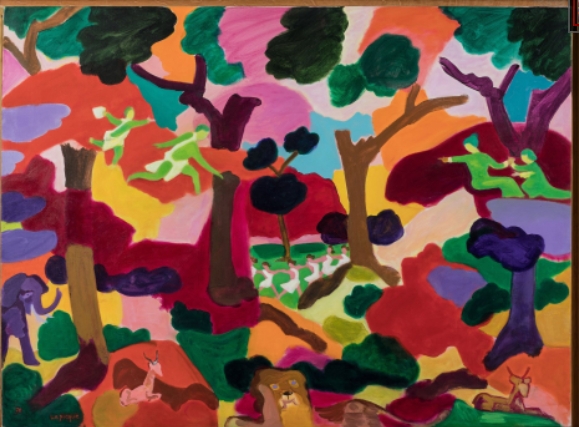 |
 mirage mirage |
||||
 |
 |
 |
|
🎨 Charles Lapicque, un nom qui résonne dans l’art moderne français comme un pont entre science, couleur et mer. Voici un aperçu de ce peintre de marine hors du commun : 🧑🎨 Biographie express
🌊 Peintre de marine et explorateur de la couleur
🧪 Entre art et science
🕊️ Engagement et distinctions
Si tu veux, je peux t’aider à rédiger une fiche optimisée
sur lui, ou même imaginer une exposition virtuelle de ses
œuvres. Tu veux qu’on s’y mette ? 🎨📘
🕊️ Engagement et distinctions
Voici quelques-unes des œuvres maîtresses de Charles Lapicque, qui illustrent son audace chromatique et sa vision singulière de l’espace : 🎨 Œuvres emblématiques
🖼️ Où les voir ? Tu peux explorer une sélection de ses œuvres internet Si tu veux, je peux t’aider à créer une fiche descriptive pour chacune, ou imaginer une exposition virtuelle autour de ses marines et chevaux. On s’y met ? 🐎🌊📘 📈 La cote de Charles Lapicque sur le marché de l’art reste dynamique et appréciée, notamment pour ses œuvres marines et ses compositions abstraites. Voici un aperçu actualisé : 🎨 Estimations par type d’œuvre
🏛️ Où suivre sa cote ?
|
| Donnez nous d'autres
informations sur l'art et la marine? participez aux blogs http://antiquairemarine.blogspot.com http://librairie-maritime.blogspot.com http://photographie-maritime.blogspot.com |
et
visitez les sites conjugués http://historic-marine-france.com http://peintres-officiels-de-la-marine.com http://librairie-marine.com |